La situation économique en zone Euro
Zone euro : une situation à surveiller de près
En 2017, le PIB réel de la zone euro a enregistré une croissance annuelle de 2,5 %, la plus vigoureuse depuis 2007. Toutefois, la situation a clairement changé en 2018. Dès le début de l’année, les résultats économiques n’étaient plus à la hauteur des attentes. Ces mauvais indicateurs ont fini par se refléter dans la croissance du PIB réel de la zone euro et l’année dernière s’est finalement soldée par une croissance annuelle de 1,8 % du PIB réel. Ce résultat a toutefois été aidé par un acquis de croissance provenant de la fin de 2017.
Quelles ont été les causes du récent ralentissement en zone euro?
La baisse de cadence de l’économie européenne est survenue au même moment où l’on observe un ralentissement du commerce mondial. Celui-ci a connu en 2017 sa plus forte croissance annuelle depuis 2011. Il est depuis en ralentissement quasi constant et a même enregistré à la toute fin de 2018 des variations annuelles négatives. Parallèlement, le commerce eurolandais s’est aussi détérioré.
Graphique 1 – Le commerce mondial a ralenti en 2018, incluant pour la zone euro
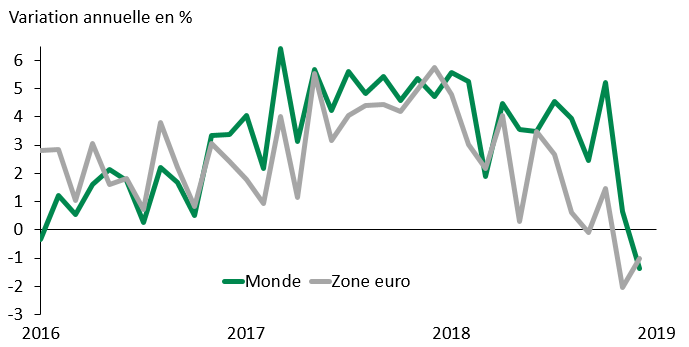
Sources : CPB – Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis et Desjardins, Études économiques
Dans le cas de la zone euro, il est intéressant de noter que la baisse de cadence provient à la fois du commerce extérieur et du commerce intérieur. Dans le premier cas, plusieurs éléments peuvent expliquer la faiblesse. La montée protectionniste américaine et les représailles exercées par l’Union européenne (UE) ont sans doute contribué à freiner les échanges entre les deux pays. Les exportations eurolandaises vers d’autres pays ont aussi ralenti. C’est le cas de la Chine, où le ralentissement graduel semble affecter les échanges avec l’Europe. Les exportations vers les pays émergents d’Europe de l’Est ont aussi diminué.
Un autre facteur de ralentissement des exportations a été la force de l’euro. Aidée par la bonne conjoncture européenne, la devise s’est appréciée de 9,0 % entre l’hiver 2017 et l’hiver 2018. En mars de l’année dernière, elle atteignait son plus haut niveau depuis l’été 2014. Cette appréciation a provoqué une perte de compétitivité pour les entreprises de la zone.
Dans le cas du commerce intérieur à la zone euro, une bonne partie du ralentissement récent provient des difficultés de certaines industries. L’ajustement du secteur automobile à de nouvelles règles environnementales plus strictes a été difficile. Toute la question des chaînes de valeur tend aussi à miner le commerce intérieur lorsque la demande est plus faible. Cela est d’autant plus vrai que l’intégration industrielle est plus importante en Europe qu’ailleurs.
La baisse de la demande intérieure dans divers pays européens a également eu un impact négatif sur les échanges commerciaux en zone euro. En 2018, huit des 19 pays de la zone euro (représentant 75,8 % de la zone) ont vu leur consommation finale diminuer. Les ralentissements les plus importants ont eu lieu en Allemagne et en Italie.
Les problèmes de l’industrie allemande
Dans le cas de l’Allemagne, les problèmes économiques proviennent de son statut de géant manufacturier de l’Europe. Il faut comprendre que le pays est encore fortement orienté vers le secteur de la fabrication. En proportion de la valeur ajoutée à l’économie nationale, seul le secteur manufacturier coréen dépasse celui de l’Allemagne au sein des pays avancés (graphique 2). Ce biais vers la production de biens fait aussi que l’économie germanique est particulièrement tournée vers l’extérieur alors que les exportations comptent pour 45,0 % du PIB (la moyenne de l’OCDE est de 28,2 %). La situation particulière de l’Allemagne la rend plus sensible aux aléas de la conjoncture mondiale.
Graphique 2 – Le secteur manufacturier est particulièrement important pour l'Allemagne

UE : Union Européenne
Sources : Organisation de coopération et de développement économiques et Desjardins, Études économiques
Cette observation est d’autant plus vraie lorsque c’est le secteur automobile qui est touché. Celui-ci représente environ 20 % de la production manufacturière allemande. En 2017, en Allemagne, 5,5 millions de véhicules pour passagers ont été fabriqués, de loin le plus gros producteur en Europe (l’Espagne arrive au deuxième rang avec 2,3 millions d’unités). Le scandale lié aux tests environnementaux sur les véhicules au diesel a frappé lourdement l’industrie automobile germanique. Le secteur de l’automobile n’est toutefois pas la seule source de difficultés et d’autres industries ont également éprouvé des problèmes.
La confiance et les facteurs politiques
Parmi les facteurs qui ont pu affecter l’économie interne de la zone euro, plusieurs éléments ont pu nuire à la confiance, dont certains sont de nature politique.
En Italie, l’élection générale du 4 mars 2018 a amené à la tête du gouvernement une coalition droite/populiste au sein de laquelle la cohabitation est difficile.
En France, on remarque une certaine insatisfaction envers le gouvernement centriste d’Emmanuel Macron. Ce sentiment culmine maintenant avec la crise des « gilets jaunes ».
La situation politique allemande est aussi plus incertaine. La chancelière Angela Merkel a confirmé qu’il s’agirait de son dernier mandat. Les débats entourant l’immigration et les difficultés économiques actuelles du pays nourrissent un certain ressentiment politique.
L’incertitude envers le Brexit constitue un autre élément perturbateur alors que le principal partenaire de la zone euro cherche à quitter l’UE.
La conjoncture pourrait-elle encore se détériorer?
Il est clair que la situation actuelle de l’économie eurolandaise est fragile. Plusieurs indicateurs continuent de pointer vers le bas. Toutefois, même ces signes peu reluisants ne donnent pas une image aussi négative qu’au cours des récessions de 2008-2009 ou de 2011-2013. La confiance des ménages et des entreprises est basse, mais encore loin des niveaux atteints durant ces deux périodes.
Parmi les facteurs qui ont nui à l’économie européenne, on a mentionné l’appréciation passée de l’euro. Il faut maintenant tenir compte du fait que la devise commune s’est dépréciée au cours des derniers trimestres. Une baisse de l’euro pourrait être ainsi favorable aux exportations, notamment vers les principaux partenaires que sont le Royaume-Uni et les États-Unis.
Graphique 3 – La baisse de l'euro devrait bientôt aider les exportations
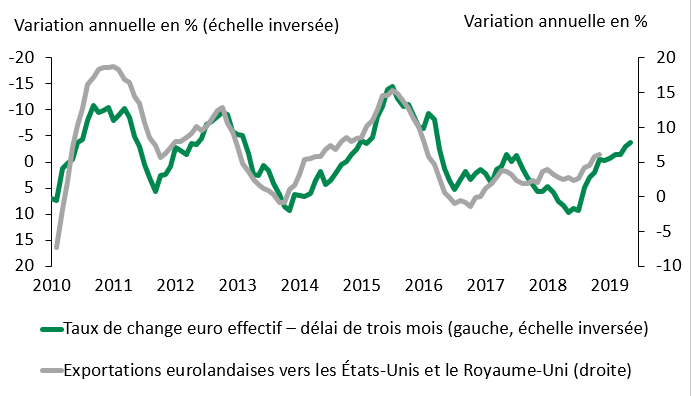
Sources : Banque centrale européenne, Eurostat et Desjardins, Études économiques
Évidemment, le Brexit pourrait changer la donne, notamment si la sortie du Royaume-Uni devait se faire sans entente une fois le présent délai expiré. De même, la mise en place de nouvelles mesures protectionnistes provenant de l’administration Trump pourrait nuire au commerce européen. Enfin, un ralentissement plus prononcé de l’économie chinoise poserait aussi des problèmes à l’économie eurolandaise.
Une mince marge de manœuvre en cas de détérioration
Dans le cas où les risques prendraient de l’ampleur et viendraient vraiment miner davantage l’activité économique, il sera intéressant de voir ce que pourront faire les autorités politiques et monétaires.
La Banque centrale européenne (BCE) dispose d’une très mince marge de manœuvre, l’institution n’ayant pas réussi à entamer la normalisation de sa politique monétaire. Les taux directeurs sont ainsi restés à leur plancher, c’est-à-dire en territoire négatif. Les diminuer à nouveau pourrait être difficile et engendrer des dysfonctionnements du marché monétaire et de l’épargne. Même se rabattre sur de nouvelles mesures quantitatives visant à regonfler son bilan pourrait être compliqué sans changer les règles de fonctionnement de la BCE.
Des ajustements à la politique budgétaire permettraient d’améliorer la situation économique de l’Europe. Cependant, les craintes d’un retour à la crise des dettes souveraines du début des années 2010 risquent de refroidir la volonté des politiciens. La principale bouée de sauvetage pourrait venir de l’Allemagne, où les surplus budgétaires s’accumulent depuis 2014 et où la dette du gouvernement en proportion du PIB est maintenue à l’un des niveaux les plus bas des pays avancés.
Sources :
Ce lien ouvrira dans un nouvel onglet. https://www.desjardins.com/ressources/pdf/pv190328-f.pdf
