Que penser de la récente montée des tensions commerciales
L’augmentation des tensions commerciales découlant de l’attitude protectionniste du gouvernement américain a été un fait saillant économique particulièrement inquiétant en 2018. À un certain moment, il était même question que l’Accord de libre-échange nord-américain soit déchiré. La signature d’une nouvelle entente entre le Canada, les États-Unis et le Mexique et la trêve observée entre la Chine et les États-Unis ont toutefois fait baisser la pression à la fin de l’an dernier. Au cours des quatre premiers mois de 2019, des signes encourageants du côté des négociations commerciales entre les deux superpuissances ont aidé à réduire l’incertitude au sujet de l’économie mondiale, ce qui a contribué à l’excellente performance des marchés financiers.
Les espoirs d’un accord imminent entre Washington et Pékin se sont cependant évanouis au début du mois de mai. L’administration Trump a alors décidé de faire passer de 10 % à 25 % les tarifs imposés l’automne dernier sur 200 milliards de dollars de biens chinois, en plus de menacer d’étendre cette mesure à toutes les importations chinoises qui avaient été épargnées jusqu’à maintenant. Sans surprise, la Chine a rapidement répliqué en annonçant à son tour de nouveaux tarifs sur les exportations américaines. Bien que les discussions entre les deux pays semblent vouloir se poursuivre, la pause dans la guerre commerciale est clairement terminée.
La réaction des marchés financiers ne s’est pas fait attendre, les places boursières ayant fortement reculé à la suite de l’imposition de ces tarifs additionnels. En soi, cet accroissement du protectionnisme entre la Chine et les États-Unis devrait avoir un effet négatif tout de même assez limité sur l’économie mondiale. L’ampleur des nouveaux tarifs annoncés jusqu’à maintenant serait comparable à celle des mesures similaires mises en place l’an dernier. Une poursuite de l’escalade tarifaire pourrait toutefois provoquer des conséquences plus néfastes, surtout si d’autres pays se retrouvaient entraînés dans le conflit. Une dispute commerciale bilatérale est moins dommageable qu’un conflit plus généralisé, puisque les entreprises touchées ont la possibilité de se tourner vers des fournisseurs et des clients établis dans d’autres pays.
L’imposition de barrières commerciales est une mauvaise nouvelle qui équivaut à l’ajout d’une taxe pour les consommateurs américains. Heureusement, ces derniers sont actuellement dans une position relativement favorable, profitant entre autres d’un marché du travail vigoureux. En répliquant aux mesures américaines, la Chine poursuit une stratégie plutôt risquée puisque l’économie chinoise montre certains signes de faiblesse depuis quelques trimestres. De plus, les Chinois bénéficient toujours en 2018 d’un imposant surplus commercial de 379 milliards de dollars US avec les États-Unis (Graphique 1). Une réaction très négative des marchés financiers pourrait aussi amplifier les impacts nocifs de la récente montée des tensions commerciales.
Graphique 1 – États-Unis : Le déficit commercial américain provient surtout de la Chine
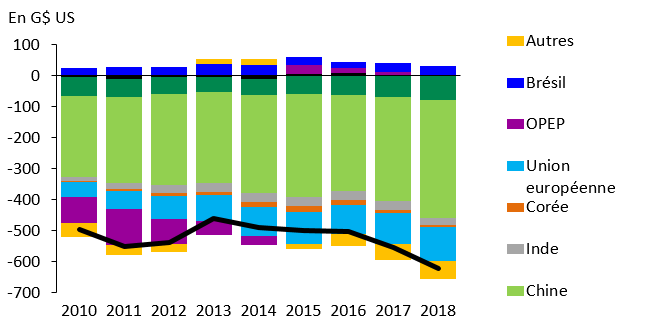
OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole
Sources : Bureau of Economic Analysis et Desjardins, Études économiques
Conséquences pour les Canadiens
Le Canada n’est pas touché directement par les nouvelles mesures tarifaires de Washington et Pékin. Certains exportateurs canadiens pourraient cependant être désavantagés si leurs clients américains ou chinois devaient ralentir leurs activités. À l’inverse, des occasions pourraient se présenter si des importateurs chinois ou américains décidaient de se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement.
L’intensification du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis risque aussi d’avoir des conséquences, positives ou négatives, sur nos propres différends commerciaux avec ces deux pays. Pour le moment, la reprise des hostilités avec la Chine semble inciter l’administration Trump à se montrer plus conciliante avec ses autres partenaires. Celle-ci a en effet décidé de reporter à plus tard l’imposition de tarifs sur les automobiles européennes et japonaises. De plus, une entente visant le retrait des tarifs américains sur les exportations canadiennes d’acier et d’aluminium a été conclue. Il ne reste plus maintenant qu’à espérer que le nouvel accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique soit ratifié prochainement.
Face à une administration américaine aussi protectionniste qu’imprévisible, il demeure particulièrement important pour les exportateurs de continuer à développer de nouveaux marchés. Des progrès sont perceptibles de ce côté, la portion des exportations internationales de biens du Québec vers les États-Unis étant passée d’un sommet de plus de 85 % au début des années 2000 à environ 70 % en 2018, pendant que la part des exportations québécoises vers l’Europe et l’Asie progressait. (Graphique 2) L’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTGP) devrait continuer à favoriser une progression graduelle de nos expéditions de biens vers l’Europe et l’Asie.
Graphique 2 – Québec : Part des exportations internationales de biens vers l’Europe et l’Asie
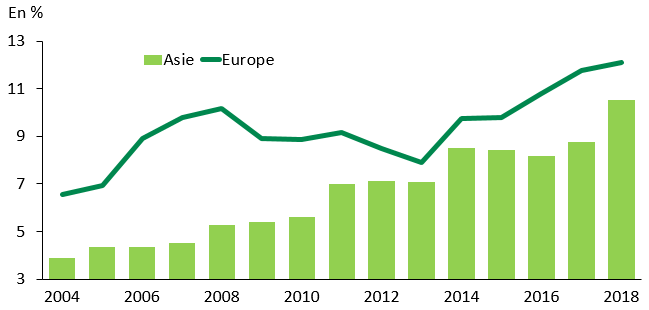
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
En ce qui concerne les investisseurs, ceux-ci doivent s’attendre à ce que les tensions commerciales contribuent à maintenir une certaine volatilité sur les marchés financiers au cours des prochains mois. Cette situation pourrait nuire temporairement aux places boursières, qui semblent déjà mûres pour une période de consolidation après le rebond spectaculaire des derniers mois. La Réserve fédérale devrait être patiente et garder ses taux directeurs au niveau actuel, d’autant plus que les nouveaux tarifs augmentent les risques d’une poussée de l’inflation aux États-Unis. La vigilance reste toutefois de mise : une escalade majeure du conflit commercial peut survenir. Cela risquerait d’entraîner une forte réduction des perspectives de croissance économique et une chute beaucoup plus marquée des Bourses.
